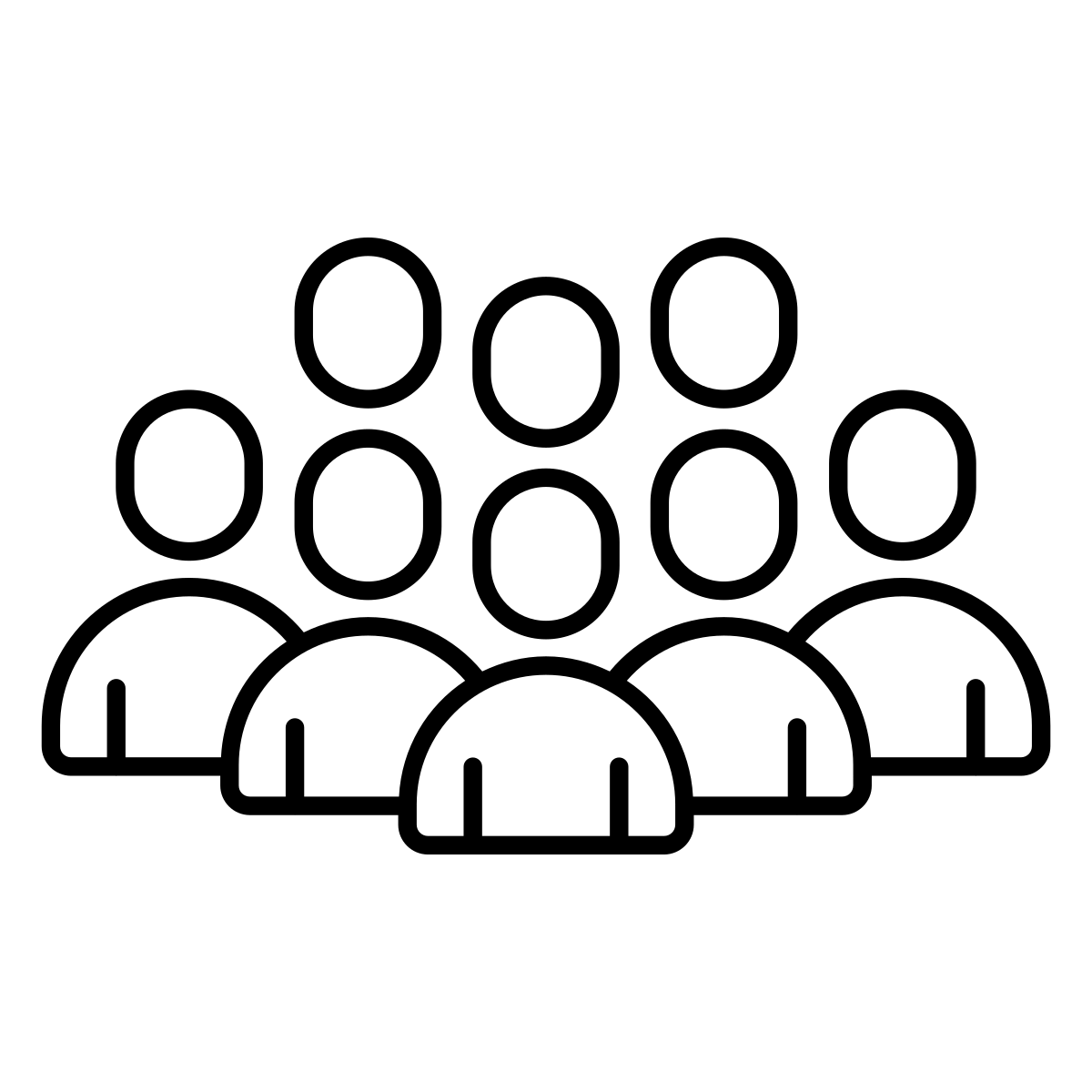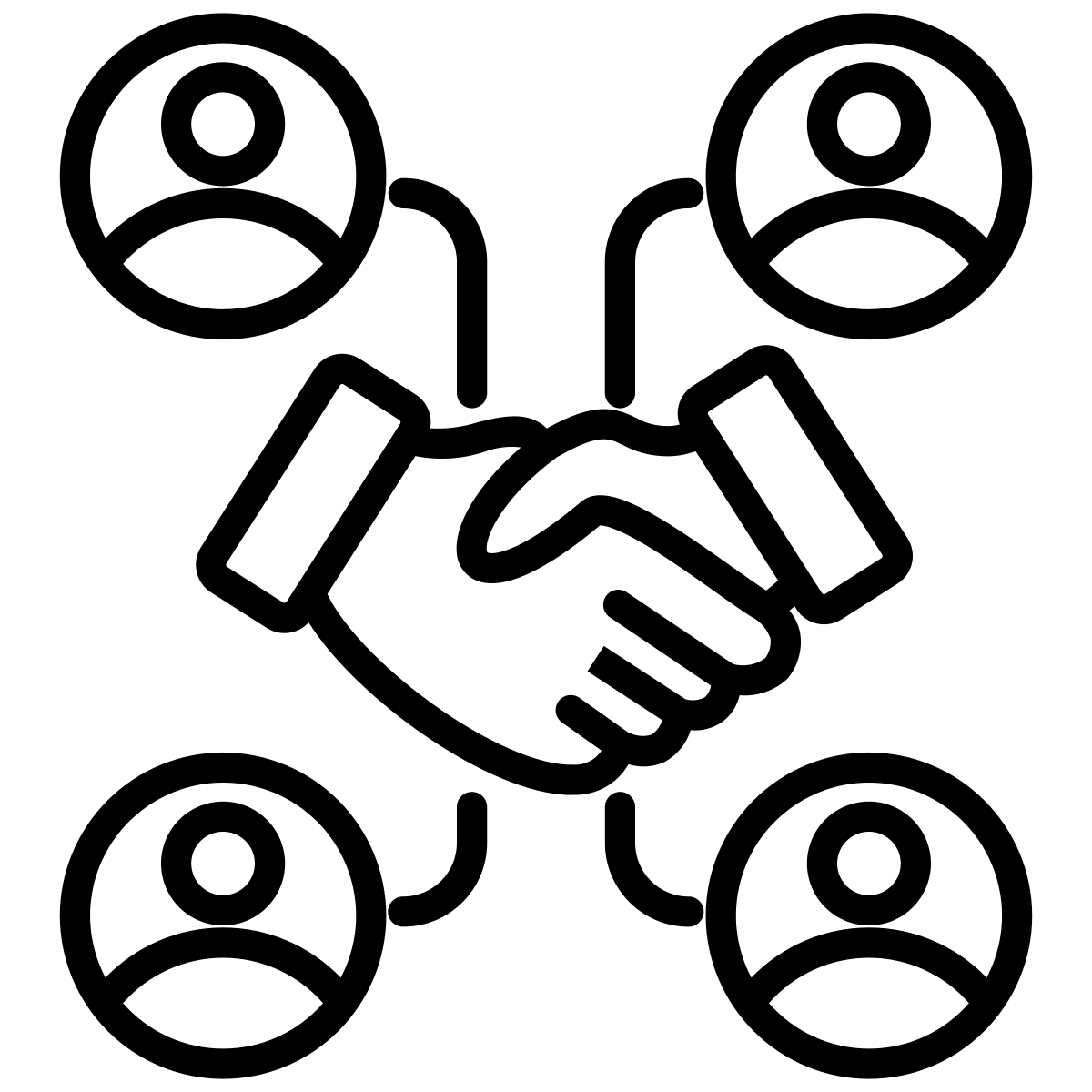VALORISATION DES ÉLUS ET PARTICIPATION CITOYENNE
Réflexions sur la qualité de la conversation démocratique



Les municipalités, comme on le dit souvent, sont des gouvernements de proximité.
C’est vrai, mais la proximité, quand on y pense, c'est essentiel à la démocratie qui est d’abord et avant tout un mode de vie associatif, une manière de vivre ensemble.
Ça suppose que les différents groupes qui composent une société démocratique puissent avoir des contacts nombreux et variés ains que des intérêts communs.
Autrement dit, plus nous avons des contacts consistants les uns avec les autres, entre les citoyens et les élus, plus la vie démocratique est riche et profonde.
On peut résumer cette idée de manière très simple: la démocratie, ça implique qu’on soit capable de se parler, de tisser des liens, même si parfois les désaccords sont profonds et sérieux, le désir de vivre ensemble et de demeurer en contact doit toujours l’emporter.
Au cours des dernières années, on constate de plus en plus que les débats politiques tournent un peu trop facilement à la foire d’empoigne. Le ton monte, les insultes et les attaques personnelles sont de plus en plus fréquentes. Tout récemment, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a fermé les commentaires sur les médias sociaux. Quelques semaines plus tôt, c’était la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard, qui lançait un cri du cœur dans une lettre ouverte pour dénoncer la dégradation du climat politique. On pourrait citer bien d’autres exemples. Plusieurs élus ont aussi choisi de décrocher.
En même temps, tout ça se passe dans un contexte où on souhaite attirer une relève en politique et favoriser la participation citoyenne. On se retrouve donc devant un souci majeur: si plus personne n’a envie de participer à la vie politique, que ce soit des élus ou des citoyens, c’est la vie démocratique qui va s’appauvrir.
Alors qu’est -ce qu’on fait? C’est un peu la question que s’est posée Julie Bourdon, la mairesse de Granby, qui préside un comité sur la démocratie municipale au sein de l’UMQ, une instance qui a été créée spécifiquement pour réfléchir à ces questions.
« On a vu depuis quelques mois plusieurs démissions d’élus municipaux. À un certain moment, on s'est dit, qu'il fallait voir, comme organisation municipale, comment on peut se positionner et comment on peut aussi aider à travailler sur cet enjeu, parce que ce qu’on souhaite, c’est toujours maintenir le rôle d’élu attractif. On veut que les gens continuent de s’impliquer. C’est pour ça que le comité a été formé. Donc, les premières rencontres ont eu lieu et depuis ce temps-là, c’est un comité très actif au sein de l’UMQ. On regroupe autant des gens des grandes villes que des gens de plus petites municipalités, un peu partout au Québec. Nous voulions être en mesure de brosser un réel portrait du terrain et de prendre les bonnes orientations pour répondre aux besoins des élus municipaux.
(...)
Depuis les dernières années, c’est un phénomène qui est en explosion. Quand j’étais conseillère à Granby, on n’avait pas de crise du logement, on n’avait pas de personnes en situation d’itinérance visible. Il y a plein d’enjeux sociaux qui n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui, qui se sont accentués dans les dernières années. Tout ça vient alourdir la tâche. La venue des médias sociaux également. Aussi, on dirait que les langues se sont déliées depuis la pandémie. Donc, les gens vont être plus enclins à être négatifs sur les médias sociaux. On peut ne pas être d’accord avec quelqu’un, mais je pense qu’il y a une manière de dire les choses.»


Comme on le voit Julie Bourdon identifie quelques sources de tensions et de stress, propices à envenimer la conversation démocratique, comme la crise du logement, le phénomène de l’itinérance qui prend de l’ampleur ou encore la crise climatique.
À ce sujet, les travaux de Mélissa Généreux, médecin conseil à la direction de la santé publique du CIUSSS en Estrie et professeure à la Faculté de médecine des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke peuvent nous fournissent de précieux éléments de réflexion. Au cours des dernières années, elle s’est penchée sur la question de la cohésion social en s'intéressant particulièrement à des situations de crise, comme la tragédie à Lac-Mégantic ou la pandémie de COVID -19. Ses travaux nous invitent à réfléchir de manière générale à plusieurs questions sociales et politiques qui bousculent les populations en créant de l’inquiétude, de l’incertitude et de l’incompréhension.
« On a essayé de comprendre quels étaient les facteurs humains ou sociaux qui pouvaient influencer la réponse psychologique et aussi la réponse comportementale lors de la crise liée à la pandémie. Ce qu’on a trouvé comme étant le principal vecteur d’anxiété ou de dépression, c’est ce qu’on appelle le sentiment de cohérence.
Le sentiment de cohérence, c’est le fait d’avoir l’impression qu’on comprend assez bien ce qui se passe, par rapport à ce qu’on est en mesure de savoir évidemment. On comprend où sont les ressources, on sent qu’on est capable de les mobiliser et que ça vaut la peine de se battre si on veut. Ensuite, l'éléments le plus importants du sentiment de cohérence, c’est qu’on sent que ça fait un sens. Ça ne veut pas dire qu’on accepte ce qui se passe, mais les ficelles sont assez bien attachées pour sentir qu’il y a un certain sens derrière ça, ce qui nous donne le goût de continuer à avancer de façon constructive. Donc, les personnes avec un fort sentiment de cohérence étaient largement moins inclines à rapporter des symptômes d’anxiété et de dépression que celles qui avaient un plus faible sentiment de cohérence.
Une fois qu’on a compris ça, on peut se dire que d'autres situations comme la crise du logement, les inégalités sociales croissantes, la polarisation des idées, la violence qui est plus présente autant en ligne que dans le monde réel, l’omniprésence du numérique qui en soi est un grand bouleversement social parce que ça va tellement vite qu’on n’a même pas le temps de vraiment s’adapter et de faire des réflexions en profondeur, tout ça pour moi, ça fait partie de ce qu’on pourrait peut-être appeler des crises sociales ou des bouleversements sociaux. Et oui, effectivement, si on s’intéresse un peu concept de résilience en temps de crise aiguë, pourquoi ne pas s’inspirer de ces apprentissages pour voir comment ça s’applique à des contextes qui semblent maintenant définir notre quotidien.»
Les constats dressés par Mélissa Généreux sur la gestion du quotidien nous laissent penser que les gouvernements de proximité comme les municipalités seront appelés de plus en plus à absorber le choc des inquiétudes, des frustrations et des vexations vécues par la population. À ce titre, fortifier le sentiment de cohérence pourrait permettre de favoriser une conversation démocratique plus sereine et constructive,
Un problème demeure toutefois. En se penchant sur le problème des incivilités et des insultes à l'égard des élus, Julie Bourdon a pu constater que les femmes sont particulièrement visées, plus fréquemment et avec plus d'ampleur, par des discours dégradants.
« Ça touche plus les femmes que les hommes, dans une proportion d’environ 60%-40%. Les propos déplacés vont être plus crus envers des femmes qu’envers des hommes. Je ne veux pas répéter ce que certaines collègues ont déjà reçu comme messages, soit à propos de leur apparence, soit en termes de violences qui leur sont adressées. »




Pascale Navarro, journaliste, conférencière et chercheuse qui s’intéresse depuis longtemps aux enjeux féministes, plus particulièrement aux questions qui touchent la place des femmes en politique et la parité, connaît bien le problème que pointe Julie Bourdon. Collaboratrice au groupe Femmes, Politique et Démocratie et et coordonnatrice du club politique Les Elles du Pouvoir, elle est en contact depuis longtemps avec des politiciennes de tous les horizons. À son avis, le problème pour les femmes est double: elles ne doivent pas seulement entrer en politique, elles doivent sortir du cadre social dans lequel elles ont été confinées tout au long de l’histoire.
« Il y a un contentieux avec les femmes et la politique. Elles partent déjà dès le début de leur parcours politique, quel qu’il soit, avec un déficit de crédibilité et des obstacles à la prise de parole qui sont liés à la socialisation des femmes et à celle des hommes.
Depuis l’Antiquité, devenir un homme, c’était savoir prendre la parole. Je parle bien sûr des hommes qui étaient privilégiés, parce qu’il y en avait qui ne l’étaient pas. Mais le masculin s’est construit sur la prise de parole et sur la maîtrise du discours, et sur l’art oratoire, sur l’art rhétorique.
Donc tout ça, ça crée une histoire, ce qui fait que les femmes sont socialisées à s’effacer, à s’occuper de l’espace privé, si on veut, par rapport à la sphère publique, et donc n’ont pas été socialisées à prendre la parole. J’ai entendu de beaucoup d’élues dire que prendre la parole, c’est un défi majeur. Donc, bien sûr qu’avec le temps, on réussit à passer par-dessus, mais beaucoup, dans les formations, demandent à se faire aider à savoir débattre, à savoir parler en public, à entendre sa voix en public.»
« Il y a toute une conversation sur les incivilités, mais qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu’on n’est pas d’accord avec ce système. Et si le système change et s’améliore, il ne va pas s’améliorer que pour les femmes. Toutes les catégories de la population vont être concernées. C’est aussi ça qu’il faut comprendre dans le mouvement de la parité.
L’autre aspect, c’est le message que lancent les gouvernements, la communication. Et là, on a un problème, parce même si beaucoup d’élus refusent ça, il y a une part plus sonore, plus audible, qui laisse passer beaucoup de choses et qui mettent ça sur le compte d’une certaine force en politique.
C’est-à-dire qu'on laisse penser que faire de la politique, ça demande d’être capable d’en prendre, ça demande d’être capable d’assumer, d’être capable de répliquer, mais il y a des choses qu’on n’a pas besoin d’assumer, qu’on ne devrait pas assumer.
On a pris pour acquis que c’était comme ça qu’il fallait que ça se fasse et on a intériorisé que c’était correct de se faire insulter, que c’était la vie. C’est comme ça, je me lance en la politique, donc il faut que j’assume. Mais assumer qu’on menace notre intégrité, qu’on menace nos enfants, qu’on nous traite de ci, de ça, mettez ce que vous voulez comme mots vulgaires et extrêmement méprisants? Non, ça ne vient pas avec la politique, c’est faux. Et ça devrait changer.
Pour moi, l’intégration des femmes dans la politique, en grand nombre, ça occasionne une réflexion sur la question, et c’est ce qu’on est en train de vivre. Oui, on vit un changement de culture, on peut s’en plaindre, parce que là, on voit le portrait, mais pour moi, c’est beaucoup plus positif que négatif. Ça veut dire qu’on en prend conscience et que même les hommes qui ne sont pas d’accord avec ça pourront aussi le dire. »
Il est vrai que nous avons développé l'idée que la politique, c’est un sport de combat et que pour prendre part au débat public, il faut se faire une carapace, une armure. Toutefois, à entretenir cette vision, on a peut-être parfois confondu les disputes normales dans un échange d’idées et les batailles de ruelles au tous les coups sont permises.
Plusieurs politiciens et politiciennes ont commencé à montrer une certaine forme de vulnérabilité. Certains pourraient y voir une faiblesse, d’autres y voient une force qui facilite les contacts avec la population et qui serait de nature à calmer le jeu, comme le pense Julie Bourdon.
« Je pense que c’est important de rappeler que les politiciens ça demeure aussi des citoyens et des citoyennes de la ville. Donc, ils vont vivre ce que les autres citoyens vivent à chaque jour. On habite nos villes, on les vit, on va à l’épicerie, oui, il y a des travaux en ville, on est aussi pris dans le trafic, on voit les enjeux sociaux comme les autres les voient.
Je pense que c’est important de maintenir cette vulnérabilité, parce lorsqu’on a une carapace trop paisse, on n’est plus en mesure de prendre des bonnes décisions pour la communauté. Effectivement, je pense que c’est important de le dire également : "Écoutez, ça nous dérange quand vous êtes irrespectueux envers nous." C’est correct d’avoir cette conversation avec la population, de ne pas tout accepter, de tracer la ligne, de dire que la limite, elle est là, puis qu’à un certain moment, si tu dépasses cette limite, ce n’est pas correct. Ça ne donne rien de plus. Donc, dis-moi les choses avec lesquelles tu n’es pas d’accord, tu peux nommer tes frustrations sans m’attaquer. Personnellement, je pense que ce sont des choses qui peuvent être dites et je pense que les politiciens sont peut-être plus à l’aise d'en parler. »
Comment ça va chez vous ? est une production des Coops de l'information
en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec
Conception, réalisation et animation : Simon Jodoin

Abonnez-vous au balado
Apple podcast
Google podcast
Spotify