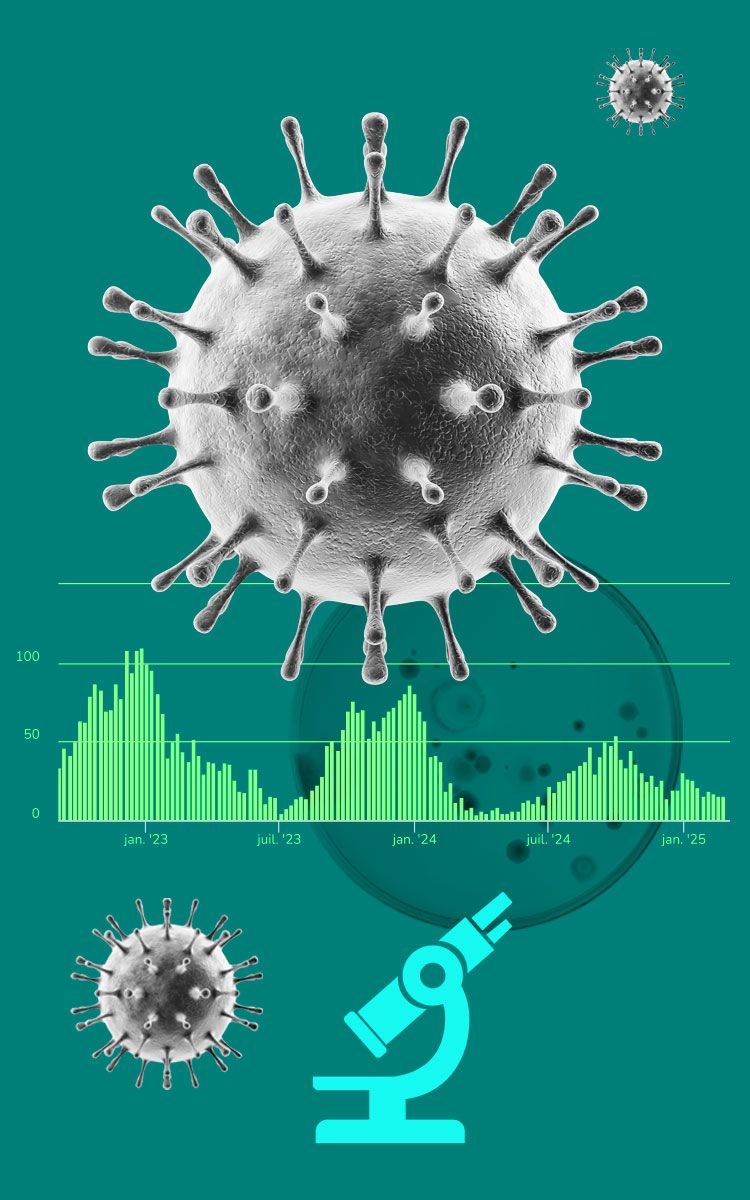COVID
QUELLES
RÉPONSES
À NOS QUESTIONS
APRÈS CINQ ANS?
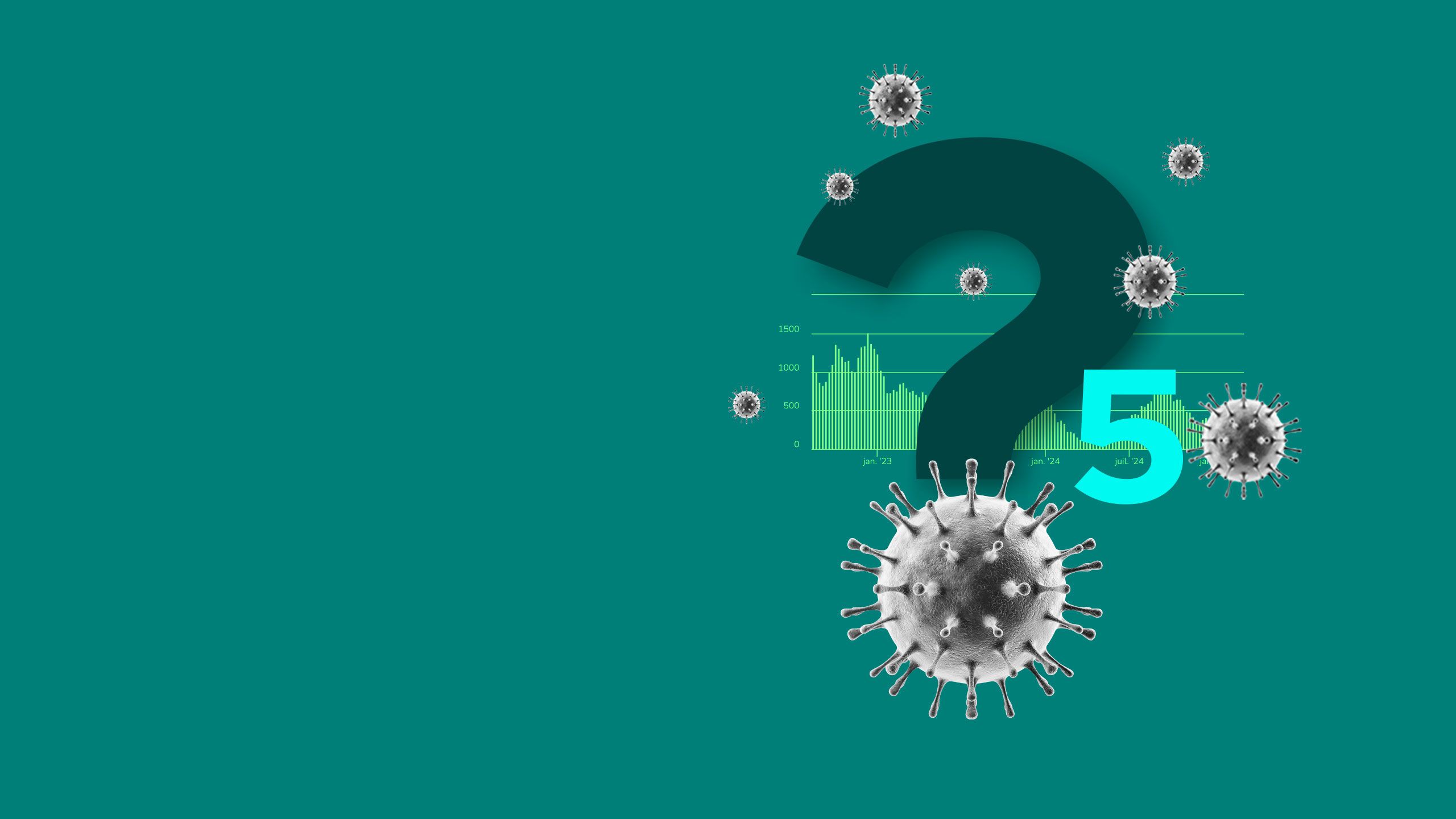
JEAN-FRANÇOIS CLICHE
jfcliche@lesoleil.com
Le Purell, qu’ossa donne? Est-ce que les masques freinent vraiment la transmission? Et puis, finalement, est-ce que les enfants étaient des vecteurs importants du virus?
Tout le monde s’est posé ces questions-là pendant la pandémie. Mais à l’époque, les réponses n’étaient souvent pas disponibles parce que la COVID-19 a forcé les gouvernements à prendre des mesures qui n’avaient jamais été essayées à grande échelle, comme le port massif du masque dans les endroits publics intérieurs ou les fermetures d’école. On n’avait donc pas d’études pour démontrer leur efficacité —, même s’il existait de bonne raisons de penser que cela fonctionnerait.
Mais maintenant, avec cinq ans de recul, est-ce qu’on a fini par les avoir, ces preuves? Le Soleil en explore quelques unes parmi les principales.
Pas d'occasion manquée, cette fois-ci
Dès le mois de juin 2020, des scientifiques s’inquiétaient.
Les pandémies passées de SRAS (2003), la «grippe porcine» (2009) et le MERS (2012) avaient donné lieu à des sprints de recherche pour mettre au point des antiviraux, des vaccins et des manières de contenir ces virus. Mais aussitôt que les crises provoquées par ces nouveaux virus s’étaient résorbées, l’intérêt politique pour ces travaux avait disparu, et les fonds de recherche en même temps. (On n’a d’ailleurs toujours pas de vaccin ou de traitement pour le SRAS ni pour le MERS.)
Alors est-ce qu’on a fini par re-rejouer dans le même film? Est-ce que des projets de recherche ont été laissés en plan, encore une fois?
«Je pense que non, dit la virologue de l’Université de Montréal Nathalie Grandvaux. J’en suis moi-même un peu étonnée compte tenu de ce qu’on a vu dans le passé, mais on voit maintenant que la recherche sur la COVID est intégrée dans les financements, c’est devenu un programme à long terme.»
«On n’a pas encore de réponses sur tout, évidemment, mais cette fois-ci les projets continuent, on ne les a pas abandonnés en plein milieu», poursuit-elle.
Voyons donc quelques unes des réponses que cela nous a données…
Les masques
marchaient assez bien...
«Les masques, c’est pour le système de santé», pas pour prévenir les infections «dans la communauté», avait déclaré en mars 2020 le directeur de la Santé publique de l’époque, Dr Horacio Arruda… À peine quelques semaines plus tard, il changeait son fusil d’épaule et défendait le port obligatoire du masque dans les lieux publics fermés.
Il faut dire que, jusque-là, l’efficacité des masques avait été testé presque uniquement dans les hôpitaux, et non dans un contexte où ce serait M. et Mme Tout-le-Monde qui le porteraient — il y avait donc une certaine logique dans la position initiale du Dr Arruda.
Depuis, cependant, de nombreuses études ont confirmé l’efficacité des masques à freiner la transmission jusqu’à un certain point, même hors des hôpitaux.
«On avait plusieurs façons de regarder ça, dit Dr Stéphane Perron, de l’Institut de la santé publique du Québec. La première, c’était quand il y avait une éclosion: on regardait ceux qui portaient le masque et ceux qui n’en portait pas, et on voyait un effet. On pouvait aussi regarder les secteurs où le masque était enlevé et d’autres où il était encore porté, et on voyait un effet là aussi.»
«À partir du moment où on connait la maladie, poursuit-il, qu’on sait que c’est le haut de l’appareil respiratoire qui est infecté et que ça sort par la bouche, c’est logique de penser que si on bloque la bouche, on va réduire la transmission, même si ça n’est pas efficace à 100%.»
Une revue de la littérature scientifique parue récemment dans les Philosophical Transactions – A a recensé 84 études à ce sujet publiées de 2020 au début de 2023. Du nombre, une forte majorité (67 études, ou 80% du total) ont conclu que les masques réduisent la transmission. Fait intéressant, 18 de ces études ont regardé l’effet du masque obligatoire dans la communauté, dont 16 ont observé qu’ils freinaient le virus.
D’autres travaux ont revisité cette question récemment, à la lumière des recherches les plus récentes, et en ont tiré des conclusions similaires.

... mais le Purell, pas tellement
Si les masques ont vu leur efficacité confirmée par la science, il en va autrement de la désinfection des mains. «Honnêtement, ça n’a probablement pas changé grand-chose», estime maintenant Dr Perron.
La plupart des études sur le sujet ont trouvé qu’il n’y avait somme toute très peu de virus «vivants» dans nos gouttelettes de salive, et que le SARS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID) survit mal sur les surfaces. Sans rendre la transmission par les surface totalement impossible, ces travaux suggèrent fortement que cela prendrait des quantités pas très réalistes de salive contaminée.
C’est vraiment par les aérosols (micro-gouttelettes qui peuvent rester dans l’air assez longtemps) et les contacts rapprochés que l’on attrape la COVID, l’immense majorité du temps. D’ailleurs, des études ont montré que la souche initiale du virus survivait mieux sur les surfaces que les variants Alpha, Bêta et Omicron — signe que l’évolution favorisait la transmission par les airs, et non par les surfaces.
«La transmission par les surfaces a probablement été surévaluée au début de la pandémie. On s’est vite rendu compte que ça n’était pas si important que ça, mais on ne peut toujours pas dire que la désinfection des mains n’en valaient pas la peine», nuance pour sa part Jean Barbeau, spécialiste de la prévention des infections à la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal.
Il est en effet très difficile, voire impossible, de quantifier un tant soit peu précisément les risques que représentent les surfaces, que ce soit pour la COVID ou pour d’autres microbes, dit-il.
Et les confinements?
Dans l’ensemble, oui, les études indiquent que les confinements et les couvre-feu ont permis de ralentir la transmission de la COVID en 2020 — pas toutes les études et certaines n’ont trouvé qu’un effet plutôt marginal —, mais la majorité penchent du côté de l’efficacité. Ce qui n’est pas étonnant au sujet d’un virus qui se transmet par contact rapproché et/ou soutenu.
Sauf que l’effet des confinements n’est pas facile à étudier. On ne peut pas «administrer» un confinement à certains individus et pas à leurs voisins, comme on le fait dans les études sur des médicaments, par exemple. Les confinements sont appliqués à de grands ensembles, si bien qu’il faut comparer entre eux des grands ensembles, parfois même des sociétés entières, en présumant qu’ils sont comparables — mais ça n’est pas toujours le cas puisqu’il y a des tonnes de choses qui varient d’un pays à l’autre.
En bout de ligne, cela donne des «preuves» d’efficacité qui ne sont pas particulièrement solides.
Par ailleurs, les confinements ont également, bien sûr, causé un certain niveau de problèmes mentaux et entraîné des retards scolaires, surtout en milieux défavorisés — mais c'est une autre question.

Les enfants transmettaient le virus (un peu)
Et les écoles, est-ce qu’on a bien fait de les fermer (ou de les rouvrir, au Québec, avant plusieurs autres juridictions)?
Il ne fait pas le plus petit doute possible que les enfants, même les plus jeunes, pouvaient refiler le virus aux plus grands. Par exemple, une étude canado-américaine parue en 2023 dans Clinical Infectious Disease a observé ce qui se passait dans les familles de 111 enfants qui venaient de tester positif à la COVID et des 256 autres qui avaient testé négatif. Au bout de deux semaines, dans les familles des enfants positifs, 11 % des gens avaient contracté le virus, contre seulement 2% dans les autres ménages.
Mais tout indique que les enfants étaient moins contagieux que les adultes. Par exemple dans une «étude de ménage» parue en 2023, où l’on regarde à combien de gens de la famille un «cas index» va transmettre la maladie, il y avait 70% moins de transmission quand c’était un enfant qui ramenait le virus à la maison que quand c’était un adulte.
Et plusieurs autres travaux ont observé essentiellement la même chose.
«Je suis d’accord avec le fait que les enfants peuvent transmettre le virus, mais pas autant que pour l’influenza tel que démontré dans les études de famille. Ça peut dépendre en partie du nombre de récepteurs ACE-2 [dont le SRAS-CoV-2 se sert pour entrer dans nos cellules et qui est moins exprimé dans les voies respiratoires des enfants]», dit Dr Guy Boivin, spécialiste des infections respiratoires au Centre de recherche du CHU de Québec.
D'où vient le virus, en fin de compte?
À cette question-là, malheureusement, on n’a toujours pas trouvé de réponse définitive — rien qui soit formellement prouvé, du moins. Mais disons que ce qu’on sait plaide quand même clairement pour une «zoonose» (le virus aurait fait le saut d’un animal à l’humain) plutôt que d’une fuite de laboratoire, qui est l’autre principale thèse sur les origines de la COVID.
Le virus possède des caractéristiques génétiques et biologiques qui cadrent mieux avec une origine naturelle qu’avec une fuite de laboratoire — voir cette chronique récente pour plus de détails et de sources. Et on a trouvé le matériel génétique du virus sur certains étals d’un marché public de Wuhan (ville chinoise où le virus est apparu), autour duquel étaient concentrés les deux tiers des tout premiers cas de COVID, à la toute fin de 2019.
En 2023, une analyse des éléments de preuve en faveur ou contre les deux principales thèses, parue dans le Journal of Virology, a conclu que les faits penchaient très clairement du côté d’une origine naturelle, sans toutefois la prouver complètement.
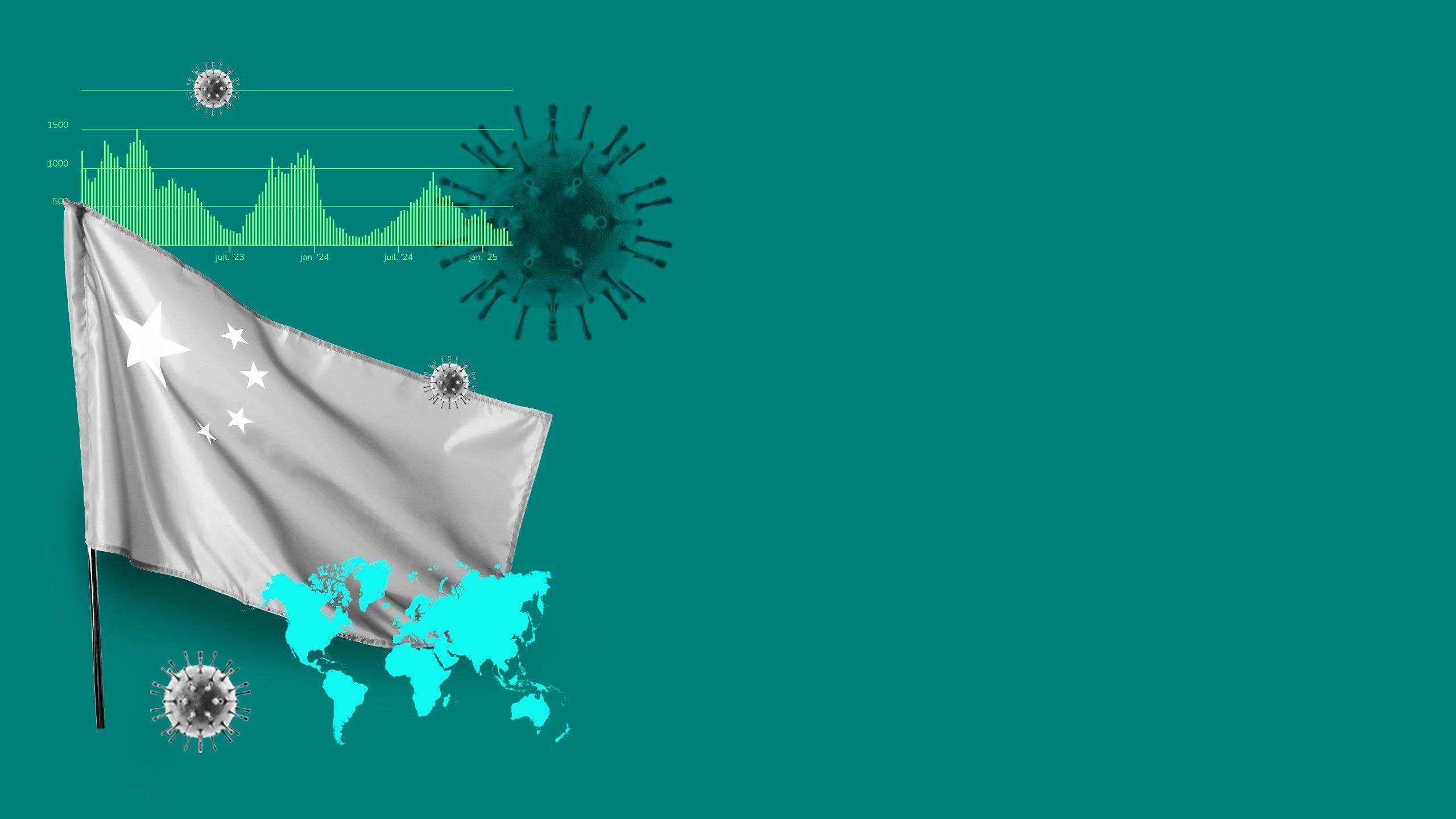
DESIGN GRAPHIQUE
PASCALE CHAYER
IMAGES
123rf